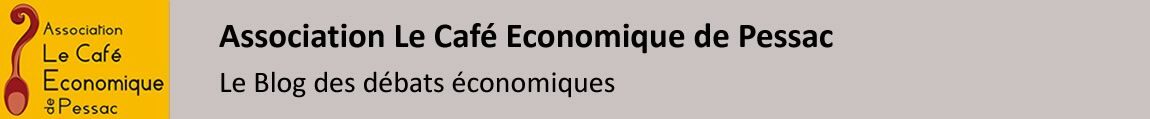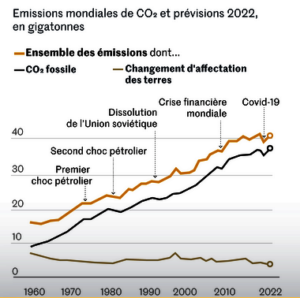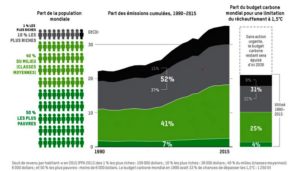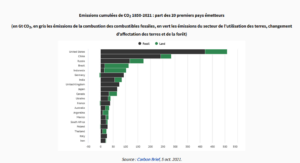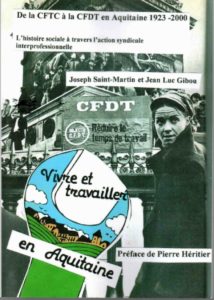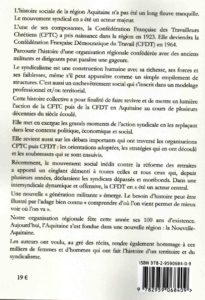Le NFP : Cap sur la redistribution
Il n’était pas évident que les forces de la gauche et de l’écologie s’entendent en seulement quatre jours sur un programme de gouvernement. Elles y sont parvenues pourtant dans le domaine économique sans trop de difficultés. Elles se sont appuyées sur leur dénominateur commun : la priorité au social par la redistribution des revenus, Voyons d’abord les grands axes du programme, puis sa logique et enfin ses implications.
Un triple changement de cap.
Le programme du NFP est axé d’abord sur la satisfaction des besoins sociaux. Il prévoit le soutien du pouvoir d’achat des ménages par la hausse du SMIC à 1600€ net, du point d’indice des fonctionnaires (10%), des APL (10%), par l’indexation des salaires sur l’inflation, par le blocage de prix des biens de première nécessité (énergie, alimentation). Il comprend aussi l’abrogation de la réforme des retraites et de la réforme de l’assurance chômage. Il inclut en outre l’embauche de fonctionnaires (éducation, santé et justice), la rénovation des bâtiments publics et la relance de la construction des logements sociaux.
Le programme comprend des réformes fiscales qui visent les ménages les plus riches à l’opposé de la politique Macron : la suppression de la flat tax et le rétablissement de l’exit tax pour les riches contribuables qui partent à l’étranger, la création d’un impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité accrue de l’impôt sur le revenu, la progressivité de l’impôt sur l’héritage.
Le programme comprend enfin des réorientations de la production à des fins d’écologie et d’indépendance. Il prévoit l’essor de filières industrielles vertes, un plan de reconstruction industrielle (médicaments, semi-conducteurs, voitures électriques), des aides aux entreprises conditionnées par le respect de critères sociaux et environnementaux. Il prévoit aussi deux conférences sociales : sur les salaires, l’emploi et la qualification et sur le travail et la pénibilité.
Une logique social-démocrate anti-néolibérale.
Ce programme relève d’une logique redistributive de type socialdémocrate avec une dimension écologique. Il privilégie l’action sur la répartition dans la recherche d’une diminution des inégalités.
Il ne va nullement provoquer une rupture avec le capitalisme ! Y voir la marque d’un quelconque extrémisme est un total contresens. D’abord, sa politique fiscale prend soin de ne pas alourdir les charges des entreprises. Ensuite, au plan des réformes structurelles, il reste très en deçà du programme de la gauche en 1981 qui incluait de nombreuses nationalisations.
Ce programme est en revanche en rupture avec le néolibéralisme qui vise à détricoter l’Etat social. Il va même relativement loin en matière de fiscalité accrue sur les plus riches. Il implique donc une nette hausse des dépenses publiques et sociales avec en contrepartie une hausse des recettes fiscales sur les plus aisés, d’où un gonflement des budgets publics et sociaux, en contradiction avec le projet macronien de les baisser.
Les perspectives de la mise en œuvre.
« Enfin, les difficultés commencent ! » s’écriait le député socialiste Alexandre Bracke-Desrousseaux en mai 1936. En cas de victoire du NFP en 2024, les difficultés ne vont certainement pas manquer non plus !
– L’état actuel des finances publiques et les normes budgétaires européennes ne laissent pas de marge pour accroitre le déficit et la dette. C’est pourquoi le volet fiscal est important. Mais si la hausse des recettes équilibre celle des dépenses, le gonflement des budgets publics sera compatible avec les règles de Bruxelles.
– Le changement de cap notamment fiscal peut susciter des réactions des milieux économiques, probables au niveau financier (bourse, taux d’intérêt) et possibles au niveau de l’investissement des entreprises avec des effets sur la production.
– La réaction de l’activité économique à cette politique va jouer un rôle clé. En l’absence de croissance, le bouclage financier sera difficile faute de base fiscales suffisantes, d’où un besoin de pression fiscale accrue avec ses risques politiques. En cas de croissance de l’activité, le bouclage financier sera plus facile, ce qui limitera la hausse de la pression fiscale et ses risques politiques.
La mise en œuvre du programme de la NFP ne va pas déclencher l’apocalypse décrite par ses adversaires. Elle va dépendre de la capacité du système capitaliste à sortir du néolibéralisme par la voie démocratique. Sera-t-il capable d’absorber plus d’égalité et éventuellement moins de rentabilité alors que les contraintes écologiques vont s’accentuer ?
Michel Cabannes, Juin 2024